

Les glucides
Rôle
Ils sont utilisés comme combustibles, pour stocker de l’énergie, comme structures de base pour l’ADN et l’ARN et comme composantes de la membrane cellulaire lorsqu’ils se lient à des molécules de lipides ou de protéines (glycoprotéines et glycolipides); ils peuvent alors exercer différents rôles comme la reconnaissance intercellulaire.
Les hydrates de carbone sont des aldéhydes (H-C=O) ou des cétones (C=O) hydroxylés; il s’agit des composés organiques les plus courants.
Il existe différentes catégories d’hydrates de carbone.
Les monosaccharides
Ceux provenant de l’alimentation sont principalement les monosaccharides de glucose, fructose et galactose. Le nom de monosaccharide provient évidemment du fait qu’ils sont composés d’une seule molécule (« mono ») de sucre (« saccharide »). À titre d’exemple, l’image suivante montre deux monosaccharides, soit le glucose et le fructose. Nous pouvons remarquer le groupement aldéhyde sur la molécule de glucose et le groupement cétone sur la molécule de fructose (ils sont en bleus). Le galactose, pour sa part, présente également un aldéhyde au début de sa chaîne (H-C=O)

Ce type d’hydrates de carbone sont des glucides simples, et ainsi, contiennent le même nombre de molécules de carbones que de molécules d’eau. Leur formule moléculaire générale est donc Cn(H2O)n. Certains chimistes aiment donc leur donner l’appellation de « carbones noyés dans de l’eau ».
Les disaccharides
Une autre catégorie de glucides sont les disaccharides. Ces molécules sont en fait le résultat de la juxtaposition de deux molécules de monosaccharides. En effet, la saccharose (ou sucrose) est en fait une molécule organique composé d’une molécule de glucose et d’une de fructose. Le lactose, retrouvé dans le lait, est en fait la juxtaposition d’une molécule de galactose et d’une de glucose. Finalement, le maltose, pour sa part, est composé de deux molécules de glucose. Les deux molécules des disaccharides sont liés par une molécule d’eau. Ainsi, le corps, pour décomposer ces molécules, devra hydrolysé les disaccharides; c’est-à-dire, rompre la liaison d’eau qui les retient ensemble. Cette rupture de la liaison se fait habituellement par les différentes enzymes présentent dans notre tube digestif.


Les polysaccharides
Pour les polysaccharides, il s’agit du même principe; ces molécules sont formés d’une chaîne plus ou moins longue de monosaccharides. Ces hydrates de carbone sont plus souvent connus sous l’appellation de « glucides complexes » car leur composition est formée d’une très longue chaîne de carbone. L’amidon est le polysaccharide le plus présent dans notre alimentation. Il est formé de deux composés, soit de l’amylose et de l’amylopectine. Tous deux sont composés de plusieurs molécules de glucose.
L’amidon est une bonne source d’énergie pour le corps, car il se transforme en monosaccharide dans une proportion de 90%. De plus, il s’assimile progressivement, surtout s’il est accompagné de fibres, soit sur une période de 4 à 8 heures.

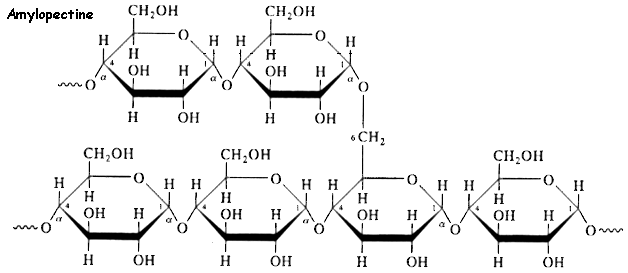
Métabolisme des glucides
Pour que l’absorption des hydrates de carbone soit possible, le corps doit désintégrer les molécules en monosaccharides. Pour ce faire, les liaisons présentent entre les molécules doivent être rompues par des molécules d’eau; on appelle ce phénomène l’hydrolyse des hydrates de carbone. Ce principe débute dans la cavité buccale; des enzymes présentent dans la bouche, soit l’amylase, active l’hydrolyse du polysaccharide.
Fait intéressant: plus la mastication est longue, plus les enzymes agissent efficacement, pouvant ainsi davantage briser les liaisons présentent entre les molécules. Par la suite, la décomposition des hydrates de carbone se poursuit dans l’estomac et puis dans l’intestin grêle où des enzymes pancréatiques permettent de briser la dernière liaison présente, soit celle entre les deux molécules des disaccharides restants. S’il s’agit du maltose, l’enzyme est le maltase, et s’il s’agit de l’isomaltose, il s’agit de l’amylo-1,6-glucosidase. Cette décomposition permet de créer des molécules de glucose.
Les polysaccharides, une fois décomposés en glucose, se font absorbés par le foie. Une partie de ce glucose est ensuite envoyé par le foie dans les vaisseaux sanguins périphériques. Ces vaisseaux sanguins passent alors près du pancréas qui, grâce à ses nombreux récepteurs, détecte la variation du glucose dans le sang et déclenche une réaction hormonale appropriée pour que l’organisme s’adapte à ce soudain changement. Cette réaction hormonale est la régulation de la glycémie. (voir texte sur régulation homéostasique de la glycémie)
Si le polysaccharides contenait du fructose ou du galactose, ces molécules resteront intact jusqu’à l’atteinte du foie. En effet, ce n’est pas la digestion qui réussit à décomposer ces molécules en glucose, mais bien le foie lui-même. Puisqu’ils font l'office d’un traitement spécial à l’intérieur du foie même, il ne sont pas envoyés dans les vaisseaux sanguins, et donc, n’influencent pas la glycémie.
L’autre partie du glucose qui avait été acheminé jusqu’au foie va se phosphorylé; une molécule de phosphate va être ajoutée à toutes les molécules de glucose pour que celles-ci deviennent trop grosses pour traverser la membrane du foie; elle n’ont alors d’autre choix que d’y demeurer ce qui permet au foie de traiter ces molécules. Les glucides phosphorylés sont alors transformés en glycogène (énorme molécules de glucose).
Or, puisque les molécules de glycogène sont liés par des molécules d’eau, elles occupent un énorme espace. Le foie, puisqu’il est de dimension limitée, peut stocker un maximum de 100 grammes de ces molécules de glycogènes transformées.
Que faire avec toutes les autres molécules de glycogène qui ne peuvent demeurer dans le foie? Celles-ci sont envoyées aux muscles, qui peuvent contenir 5 fois plus de glycogène que le foie, soit un total de 500g.
Or, lorsque la prise de glucose était très importante lors du repas, il se peut qu’après avoir stocker le glycogène dans le foie et les muscles, il en reste encore. C’est alors que cet excédant sera transformé par le foie en tryglycérides, qui seront alors emmagasinés dans les tissus adipeux. Puisque les tissus adipeux sont très élastiques, il n’y a pas de limite de stockage de glycogène sous forme de triglycérides dans ceux-ci.
